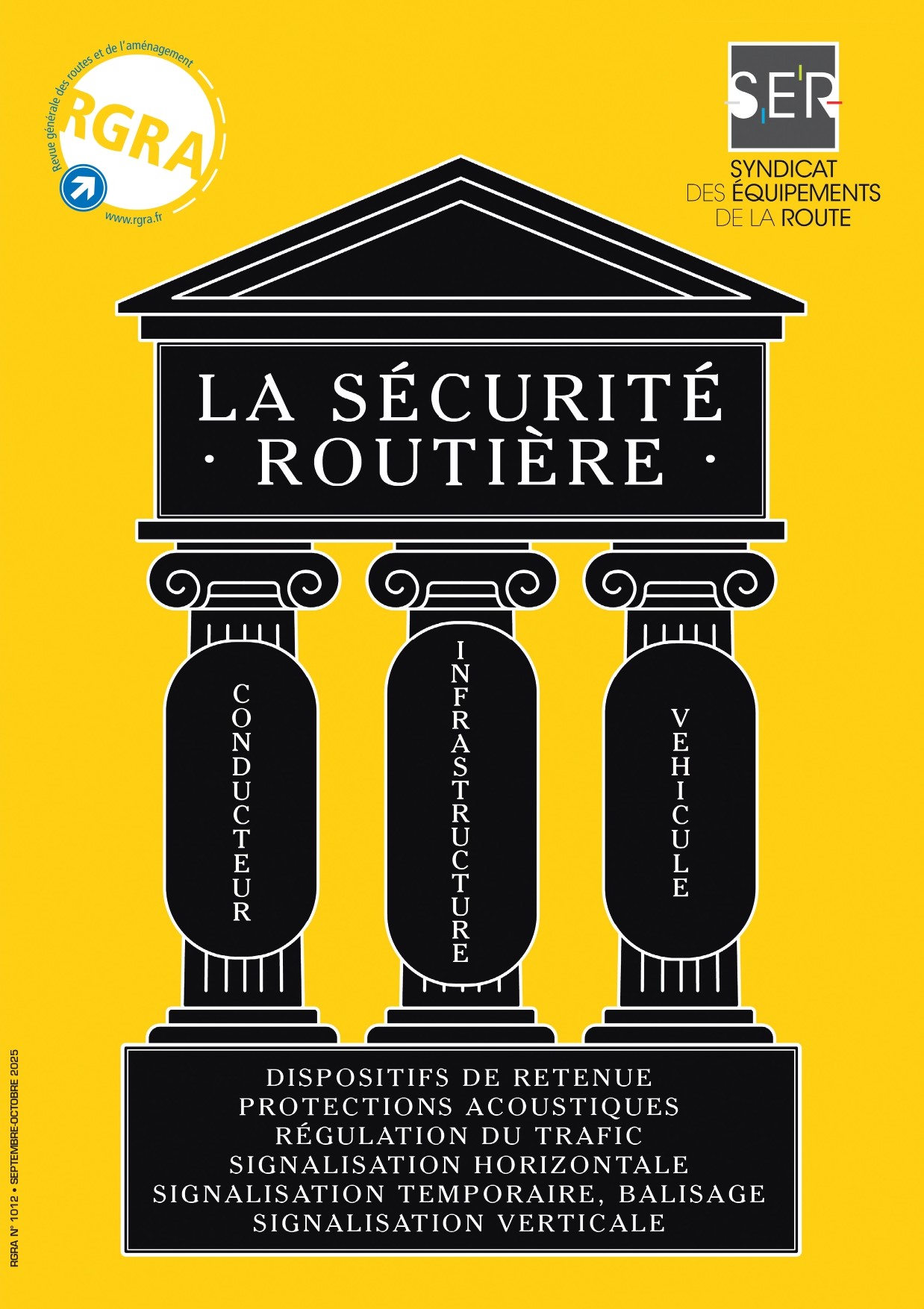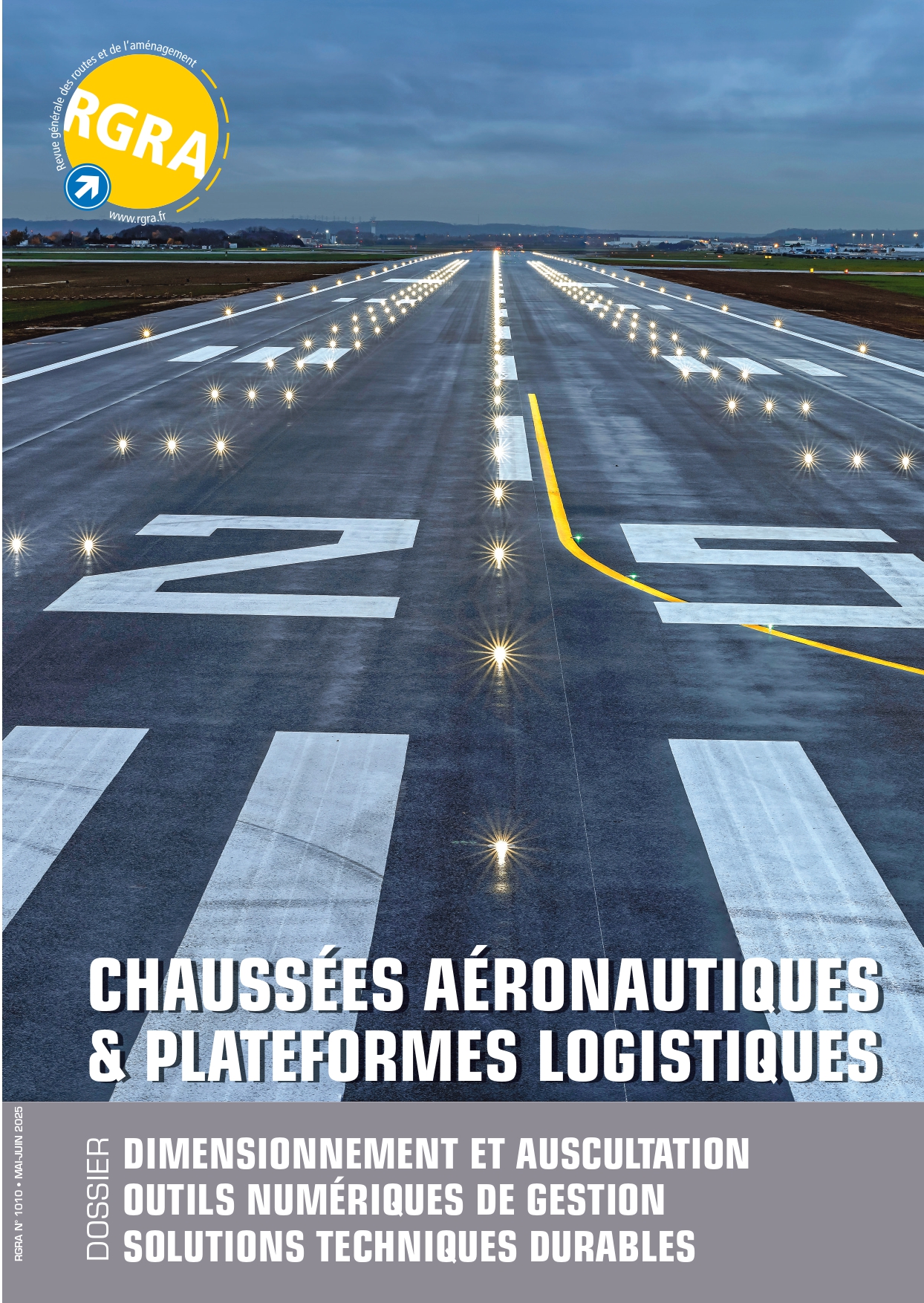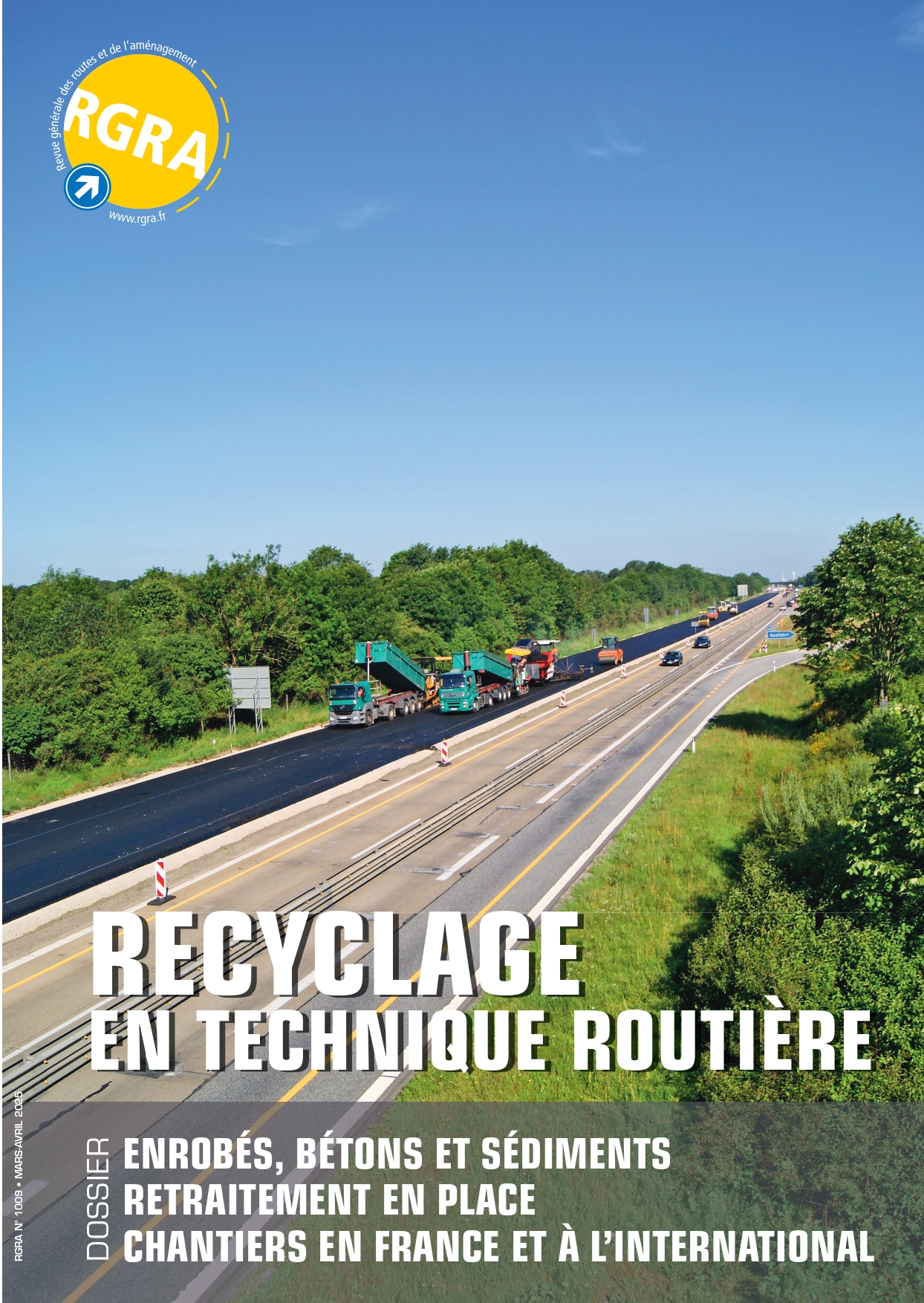Après avoir construit sa réputation sur la solidité et la durabilité des infrastructures routières et aéroportuaires, le béton est aujourd’hui également plébiscité dans les aménagements pour ses capacités à rendre la ville belle, confortable, fonctionnelle et adaptée aux différents modes de transport tout en apportant des solutions en phase avec les défis écologiques et climatiques actuels.
• Il contribue à réduire les effets d’îlots de chaleur urbains et diminue les coûts énergétiques liés à l'éclairage nocturne.
• Il permet la réutilisation et le recyclage des ressources, agissant également comme un puits de carbone grâce à sa capacité de carbonatation.
• L’utilisation de ciments à empreinte carbone réduite et l'optimisation des formulations peuvent considérablement diminuer les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de béton.
• Le béton aide à réduire la consommation énergétique des véhicules sur les routes et favorise une durée de vie prolongée des infrastructures tout en minimisant la nécessité d'entretien grâce à sa robustesse.
Les entreprises spécialisées, adhérentes du Specbea, les fournisseurs de liants et de bétons adhérents de France Ciment et du SNBPE, ainsi que l’ensemble de la filière innovent régulièrement pour proposer de nouvelles finitions et de nouveaux gestes, de nouvelles matières plus respectueuses de l’environnement ou de nouvelles techniques pour multiplier l’offre et répondre à une exigence de plus en plus qualitative des aménageurs.
Les aménagements en béton accompagnent désormais la mutation des agglomérations face aux enjeux climatiques et environnementaux :
- La durabilité et la résistance-résilience du béton par rapport aux aléas météorologiques, comme les fortes chaleurs ou les épisodes pluvieux extrêmes en font un matériau particulièrement adapté et doté d’un bilan global économique comme environnemental positif.
- En proposant des surfaces claires, le béton participe à la lutte contre les îlots de chaleur urbains et offre l’opportunité de réduire la facture énergétique liée à l’éclairage de nuit.
- Le béton participe à la préservation des ressources par sa capacité à être réutilisé, recyclé et valorisé.
- Drainant, participant au stockage de CO2 ou encore dépolluant, il devient un véritable acteur « environnemental ».
Aménagements en béton : de nombreux ouvrages concernés
La maîtrise d’un projet d’aménagement en béton décoratif appelle une concertation étroite entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprise d’application, pour assurer entre autres : le rendu esthétique, fondé sur le choix des constituants du béton et la finition adaptée, la prise en compte des exigences environnementales et d’exploitation, les propriétés mécaniques…
Les différentes solutions béton permettent aux piétons, aux vélos, aux transports collectifs et aux autres véhicules de circuler harmonieusement et en sécurité dans un même espace, de rendre élégants l’aménagement d’un parking ou les abords d’un lieu patrimonial, d’autoriser la réalisation de visions créatives diverses sur une place ou dans un parc urbain, de structurer les espaces par des jeux de formes, de couleurs ou encore des incrustations.
Ainsi, chaque contexte contribue à définir un aménagement en béton adapté aux différentes exigences et attentes (photos 1 à 4).
photo_2.jpg

photo_3.jpg

photo_4.jpg

photo_5.jpg

Des millions de mètres carrés de solutions béton variées et adaptées sont ainsi mises en œuvre chaque année. Un succès qui ne doit pas faire oublier que la fabrication et la mise en œuvre de ces bétons décoratifs nécessitent l’intervention de producteurs et d’entreprises qualifiés et d’un personnel formé aux techniques de réalisation.
Empreinte carbone d’un aménagement en béton
L’approche environnementale des chantiers, et plus généralement des ouvrages et infrastructures, est devenue incontournable.
Les acteurs de la construction agissent pour réduire leurs impacts sur l’environnement depuis de nombreuses années, que ces impacts soient visibles (déchets ou autres pollutions générés par les chantiers) ou non, notamment par l’analyse du cycle de vie (ACV), méthode d’évaluation des impacts environnementaux d’un produit ou d’un service tout au long de son cycle de vie.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont aujourd’hui clairement associées au réchauffement climatique et à ses conséquences. Dans cet article, seul l’impact carbone des réalisations et aménagements est abordé. Quant aux données relatives à l’ensemble des indicateurs environnementaux listés dans la norme NF EN 15804 +A21, elles sont évaluées, partiellement ou en intégralité, dans :
- les déclarations environnementales de produit (DEP) ciments édités par France Ciment ;
- le configurateur économique et environnemental de France Ciment, Perceval ;
- le configurateur de fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) bétons du SNBPE, Betie ;
- la base Inies.
L’étude d’un chantier traditionnel en béton désactivé, matériau plébiscité pour ses qualité esthétiques, fonctionnelles et de durabilité face aux différentes agressions mécaniques, physiques et chimiques (orniérage, poinçonnement, arrachement, gel et sels de déverglaçage…), permet de prendre la mesure de la décarbonation des projets d’aménagement en béton.
Les caractéristiques de l’ouvrage (voirie, trottoir, place de marché…) sont les suivantes :
- Réalisation dans une zone géographique de gel faible ou modéré et un salage peu fréquent (figures 1 et 2). Classe d’exposition correspondante : XF1.
- Matériaux :
- Granulats de roche massive, Dmax retenu pour considérations esthétiques : 12,5 mm.
- Ciment « moyen pondéré français » (611 kg CO2eq/t, France Ciment mars 2024, cf. figure 5) dosé à 310 kg/m3 de béton.
- Adjuvantation typique plastifiant + entraîneur d’air (même si pas obligatoire pour la classe XF1), pour faciliter la mise en œuvre et garantir la tenue au gel. - Réalisation de la désactivation par voie humide.
- Distances moyennes en France métropolitaine pour les constituants et centrale à béton – chantier :
- Carrière de granulats – unité de fabrication béton : 30 km.
- Cimenterie – unité de fabrication béton : 150 km.
- Usine d’adjuvants – unité de fabrication béton : 300 km.
- Unité de fabrication du béton – chantier : 20 km. - Distance chantier – agence travaux : 50 km.
- Prise en compte d’un entretien décennal pour le scellement des joints et pas de régénération de surface (béton désactivé).
figure_1.png

figure_2.png

En considérant une unité fonctionnelle de 1 m² de béton d’épaisseur 0,15 m et une durée de vie de l’ouvrage de 50 ans (l’application de la norme NF EN 206 +A2-CN, associée à une mise en œuvre conforme aux règles de l’art, « garantit » cette durée de vie minimale), la simulation Perceval décompose l’empreinte carbone d’une route en béton sans fondation comme indiqué dans le tableau 1.
tableau_1.png

Le matériau béton est reconnu pour sa durabilité intrinsèque, qui ne nécessite que très peu d’entretien. Cela se traduit par un impact environnemental important lors de la phase construction comparé à la phase entretien sur les décennies de vie de l’ouvrage : dans l’exemple présenté, 98 % de CO2eq sont émis initialement, contre seulement 2 % lors des quatre entretiens décennaux.
Par ailleurs, on observe dans cet exemple que le matériau béton, dont l’empreinte est de 201,7 kg CO2eq/m3 représente, avec environ 30,3 kg CO2 eq/m², la majorité des émissions de l’opération sur tout son cycle de vie (96 %).
Si l’on considère l’empreinte carbone du matériau béton sur toute sa durée de vie (figure 3), on constate que le liant (ciment) est la principale source d’émissions. C’est donc l’axe prioritaire pour décarboner le béton.
figure_3.png

Durant le chantier d’un centre bourg réalisé en béton désactivé par les équipes du groupe Sols en 2021 dans la Drôme, l’empreinte carbone liée à la fabrication du matériau béton apparaît prépondérante (figure 4). Une analyse plus fine des processus de fabrication du matériau avec la méthode Bilan Carbone® de l’Ademe contribue à rendre compte des émissions de GES des composants du béton, voire de l’ensemble des intrants d’un chantier d’aménagement (figure 5).
figure_4.png

figure_5.png

Cette étude révèle que, pour un aménagement réalisé selon les modes opératoires et moyens habituels à ce type de réalisation, c’est le poste fabrication du béton qui contribue proportionnellement le plus aux émissions de GES (environ 90 %). Au sein du matériau béton, c’est bien la fabrication du ciment qui est le poste le plus contributif, là encore de façon prépondérante (91 % des émissions du béton).
Compte tenu de l’évolution de l’offre cimentière et de la normalisation de nouveaux liants, ce rôle prédominant du ciment dans les émissions associées aux métiers de l’aménagement apporte paradoxalement de fortes perspectives d’amélioration des bilans d’émissions.
Solutions de décarbonation disponibles et à venir
Avant de chercher à optimiser « la matière », il est primordial de vérifier que les exigences sont fondées et de s’interroger : quelles performances doit-on contractualiser ?
Cette réflexion concerne le donneur d’ordre, son maître d’œuvre et leurs bureaux d’étude, en charge de définir le cahier des charges de l’ouvrage ou de donner les éléments permettant de le définir par des experts de la construction. Il convient d’abord de viser la sobriété, d’éviter la « sur-qualité » : « le bon béton au bon endroit ».
On peut citer deux exemples susceptibles de générer de la « sur-qualité » :
- Classe d’exposition en adéquation avec les contraintes de l’ouvrage et non surévaluée. Pour rappel, le respect des exigences de la norme NF EN 206 +A2/CN et des règles de l’art de mise en œuvre permet de garantir sans entretien structurel une durabilité minimale de 50 ans.
Gain potentiel : pour une classe XF1, le dosage minimum en ciment imposé par la norme est de 280 kg/m3 ; il est de 340 kg/m3 pour une classe XF4 (pour des bétons de Dmax 20 mm). Pour un ciment moyen pondéré français (611 kg CO2eq/m²), cette différence de dosage représente environ 37 kg CO2eq/m3 de béton, soit 5,6 kg CO2eq/m² pour une épaisseur de 15 cm. - Épaisseur de la couche de béton : chaque centimètre compte pour garantir la durabilité sur la période considérée. Diminuer l’épaisseur réduira considérablement la durée de vie de l’ouvrage, l’augmenter aura l’effet inverse.
Gain potentiel : dans l’exemple ci-dessus, on compte environ 2 kg CO2 eq/m² pour chaque cm de béton. Les épaisseurs minimales, définies dans les normes et guides de dimensionnement, sont fonction de différents paramètres (trafic, qualité du support…).
Utilisation de ciments bas carbone
Une fois les exigences fixées pour des objectifs partagés de performances, d’usage et de durabilité, une des pistes prioritaires à travailler pour réduire l’empreinte carbone d’un aménagement en béton concerne les optimisations possibles concernant le liant, et en particulier l’utilisation de ciments à empreinte carbone réduite.
Historiquement et aujourd’hui encore, dans de nombreux pays étrangers, la référence est le ciment CEM I (ancien CPA) que l’on utilise encore dans la plupart des bétons de travaux publics et bâtiments. Ce ciment, constitué à plus de 95 % de clinker, est certes le ciment le plus réactif, mais de fait le plus émetteur de carbone. Pour les producteurs métropolitains adhérents de France Ciment, la DEP collective établie en mars 2024 le positionne à 748 kg CO2eq/t. Pourtant, l’offre cimentaire a toujours été diversifiée, ne serait-ce que pour offrir des ciments adaptés aux environnements agressifs, comme les fondations.
Chaque ciment possède des caractéristiques qui lui sont propres, avec des performances physiques et mécaniques normalisées (NF EN 197-12). En réponse aux ambitions environnementales, cette offre continue à se développer avec de nouveaux ciments recomposés (c’est-à-dire comprenant d’autres constituants que le clinker) disposant d’empreintes carbones relativement faibles, comme les derniers CEM II C/M et CEM VI (NF EN 197-53 de 2021), et des ciments à partir de fines de béton recyclé (NF EN 197-64 de 2023).
La figure 6 représente l’offre cimentaire française indicée des empreintes carbone de chaque type de ciment produit par les adhérents de France Ciment.
figure_6.png

En théorie, il est possible de formuler un béton d’aménagement avec un CEM I comme avec un CEM III/C ou un récent CEM VI. Mais il est très rare de pouvoir changer de ciment dans une formule de béton sans conséquences sur certaines propriétés ni ajustement de formulation. L’exemple le plus courant concerne le ralentissement possible des montées en résistance à jeune âge avec des ciments fortement recomposés (et donc bas carbone), phénomène amplifié par temps froid.
Cet allongement du temps nécessaire à l’obtention de certains niveaux de résistance n’est pas sans impact sur les modalités d’obtention des finitions des états de surface et sur leur qualité esthétique générale ou encore sur les délais de remise en service des ouvrages. En effet, le recours aux adjuvants accélérateurs de prise et/ou durcissement ne permet pas toujours de retrouver des délais usuels.
Dans l’exemple présenté ci-avant, passer d’un ciment CEM I à un CEM III/B entraînerait une diminution significative des empreintes carbone (tableau 2).
tableau_2.png

Parmi les ciments dits bas carbone régulièrement utilisés, notamment en aménagements bétons esthétiques, on peut citer les CEM II/B, les CEM III/A et les CEM III/B.
Le CEM III/C est aujourd’hui le ciment normalisé contenant du clinker le plus décarboné : il contribuerait à diminuer l’empreinte carbone d’environ 70 % comparé à un CEM I à dosage équivalent. Mais il présente encore certaines difficultés pour une utilisation courante en aménagement urbain. En effet, dans ce domaine d’application, la mise en œuvre et la réalisation des finitions esthétiques nécessitent un minimum de réactivité.
Exemples d’aménagements en bétons à empreinte carbone réduite
Tous les bétons d’aménagement sont susceptibles d’être décarbonés. Concernant la réduction de l’empreinte carbone des aménagements présentés dans les photos 5 à 12, il a été fait le choix de préciser uniquement une estimation fondée sur la nature du ciment utilisé, en considérant :
- l’utilisation de ciments produits en France par les adhérents de France Ciment ;
- une formule béton référence en ciment CEM I (748 kg CO2eq/t) ;
- un même dosage en ciment et sans ajouts spécifiques ;
- une contribution de l’ordre de 90 % du liant à l’empreinte carbone du béton,
photo_5.jpg

photo_6.jpg

photo_7.jpg

photo_8.jpg

photo_9.jpg

photo_10.jpg

photo_11.jpg

photo_12.jpg

Les pourcentages de réduction carbone des bétons utilisés peuvent être considérés comme étant de l’ordre de :
- 20-25 % avec un ciment CEM II/B-S ou liant équivalent en CEM I ou CEM II/A + laitier ;
- 25-30 % avec un ciment CEM IV/A ;
- 30-35 % avec un ciment CEM V/A ;
- 35 % avec un ciment CEM II/C ;
- 50-55 % avec un ciment CEM III/B.
Il convient de rappeler que chaque ouvrage répond à des spécifications qui lui sont propres. Il n’est donc pas opportun de comparer les réductions carbone obtenues sur différents chantiers (empreinte globale et pas que béton) sans tenir compte :
- des exigences mécaniques propres à la destination de l’ouvrage, ainsi qu’à sa classe d’exposition telle que définie dans la norme NF EN 206 +A2-CN ;
- des conditions climatiques lors de la mise en œuvre ;
- des contraintes concernant le délai de remise en service ;
- des spécificités de formulation liées au critère esthétique : Dmax granulat influençant le dosage minimal en liant, technique de traitement de surface…
Optimisation de la formulation du béton
La norme NF EN 206-1 +A2/CN ne cesse d’évoluer et offre la possibilité de formuler des bétons selon une approche prescriptive traditionnelle (un ciment), une approche prescriptive élargie ou bétons d’ingénierie (ciments + additions), voire une approche performantielle fondée sur la mesure d’indicateurs de durabilité, en lien avec l’environnement de l’ouvrage (classes d’exposition).
Comme pour l’utilisation de ciments à empreinte carbone réduite, ces solutions qui font évoluer la formulation du béton devront prendre en compte les spécificités du chantier, qu’elles soient d’ordre techniques, esthétiques, climatiques ou économiques, et garantir le respect des contraintes associées (délai de remise en service ou aspect du matériau par exemple). Les gains potentiels attendus sont équivalents à ceux liés à l’utilisation de ciments bas carbone.
Le choix des granulats peut aussi être considéré. Même si les aménagements décoratifs font souvent la part belle à des gravillons choisis en premier lieu pour leur intérêt esthétique (calcaires clairs ou légèrement ocres, roches massives uniformes…), leur empreinte carbone peut être réduite :
- en recourant au nombre important de possibilités en limitant leur lieu d’extraction à moins de 200 km ;
- en privilégiant, le cas échéant, leur transport par voie fluviale.
Les gains ne seront pas du même ordre que ceux des solutions précédentes, mais traduisent un engagement pour des émissions réduites.
Prise en compte des aspects matériels et humains
Même si ces postes d’émissions sont marginaux, les démarches d’amélioration associées à la méthode Bilan Carbone® visent à considérer tous les postes d’émissions, quelle que soit leur contribution.
Ainsi, les déplacements des intervenants et opérateurs pour se rendre au chantier doivent de préférence se faire en commun, avec des véhicules récents et régulièrement entretenus, et leurs conducteurs doivent être formés aux principes de l’écoconduite.
Les encadrants doivent envisager des motorisations moins émettrices lors du renouvellement de leur véhicule et considérer l’intérêt de réunions à distance afin de limiter les longs déplacements.
Le béton peut être livré avec des camions bénéficiant des dernières évolutions technologiques (par exemple motorisation GNV ou hybridée électrique pour la toupie), qui commencent à se déployer.
Les opérateurs peuvent être formés à une gestion rigoureuse des déchets par le tri et le recyclage ainsi qu’aux contrôles et mesures limitant la surconsommation du béton mis en œuvre et du béton commandé, dont le surplus, bien que majoritairement recyclé, n’est pas anodin en terme d’émissions.
D’importants progrès sont également espérés dans le domaine des équipements et matériels : si les petites bennes basculantes motorisées (dumpers) électriques ne sont plus rares sur les chantiers, les outils de découpe et de traitement mécanisés du béton restent encore majoritairement thermiques du fait de leur performance.
Recyclage du béton dans le béton
Le recyclage du béton dans le béton a fait l’objet du projet national Recybeton5.
Dans un mètre cube de béton, l’empreinte carbone des granulats peut être considérée comme faible : de 1,5 kg CO2eq/t pour les granulats recyclés à 2,75 kg CO2eq/t pour les granulats de roche meuble. La substitution des granulats naturels par des granulats recyclés n’a donc pas un impact significatif sur l’empreinte carbone de la formule béton : de l’ordre de -1 kg CO2eq/m3 de béton pour 50 % de granulats recyclés.
Mais l’introduction de matériaux recyclés peut :
- limiter le CO2 émis par les transports nécessaires à l’acheminement des matériaux naturels s’ils sont éloignés de la centrale ;
- valoriser du carbone potentiellement piégé dans les granulats recyclés (jusqu’à 22 kg CO2eq/t de recyclés si ces derniers sont soumis à une carbonatation accélérée, cf. les résultats du projet national FastCarb6).
L’utilisation de granulats recyclés peut en revanche « alourdir » l’empreinte carbone du béton. En effet, au-delà d’un certain dosage de substitution des granulats naturels par des recyclés, estimé entre 15 et 30 % suivant la formule, la plus forte absorption d’eau des agrégats peut conduire à augmenter les dosages en adjuvant et en liant pour conserver les propriétés à l’état frais et durci du béton et donc augmenter son empreinte carbone.
L’approche constructive doit donc être globale et prendre en compte tous les paramètres afin de proposer la solution la plus durable et responsable.
Effets du béton sur la décarbonation et l’environnement
L’utilisation de béton dans les aménagements a des effets indirects sur la décarbonation et sur l’environnement :
- L’albédo élevé des bétons esthétiques de couleur claire contribue à limiter le réchauffement climatique, le phénomène d’îlot de chaleur et la puissance énergétique nécessaire à l’éclairage urbain.
- La carbonatation du béton est le phénomène inverse de celui des émissions de CO2 qui se produit lors de la fabrication du clinker. Pendant toute sa durée de vie, le béton durci voit les oxydes de calcium (CaO) résiduels véhiculés par l’eau interstitielle être amenés en surface du béton, où ils captent le CO2 atmosphérique pour former du calcaire (CaCO3). On estime ainsi que sur 50 ans (vie de l’ouvrage et déconstruction), environ 22 kg CO2eq sont captés par mètre cube de béton.
- De nombreuses études et expériences internationales ont montré que le fait de rouler sur des routes en béton permet de réduire jusqu’à 6 % la consommation énergétique du véhicule par rapport à une route en matériaux bitumineux, phénomène amplifié par un temps chaud, de lourdes charges et une vitesse réduite7.
- La garantie minimale de durabilité du béton est de 50 ans en respectant les normes et règles de l’art de mise en œuvre et sa durée de vie peut dépasser 100 ans lorsque les exigences de formulation sont plus élevées, comme dans les ouvrages de génie civil réalisés conformément au fascicule 658. Les caractéristiques des bétons d’aménagement à plat sont souvent relativement élevées, comparables à celles des ouvrages de génie civil. Calculer et mesurer une empreinte carbone à la construction est une première étape. Considérer la vie de l’ouvrage, le besoin d’entretiens (ou pas) est la seconde étape. En effet, les décennies sans travaux (importants) sont autant de diviseurs à appliquer sur l’empreinte carbone et les autres indicateurs calculés lors de la construction.
Conclusion
Face aux défis climatiques actuels, la décarbonation des aménagements en béton représente un enjeu majeur. Grâce à l'innovation constante des acteurs de la filière, de nouvelles solutions émergent, contribuant à réduire l'empreinte carbone de ces aménagements tout en conservant les qualités esthétiques et fonctionnelles du béton. L'utilisation de ciments bas carbone, l'optimisation des formulations et le recyclage des matériaux sont autant de leviers à exploiter pour garantir des infrastructures durables et respectueuses de l'environnement. L'avenir des villes et infrastructures repose sur cette synergie entre performance et responsabilité écologique.
Références
- NF EN 206+A2, « Béton - Spécification, performances, production et conformité », mars 202
- NF EN 197-1, « Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants », avril 201
- NF EN 197-5, « Ciment - Partie 5 : ciment Portland composé CEM II/C-M et Ciment composé CEM VI », mai 2021.
- NF EN 197-6, « Ciment - Partie 6 : ciment à base de matériaux de construction recyclés », juin 2023.
- J. Roudier, H. Colina, F. de Larrard, « Projet national Recybéton – Synthèse des recommandations », RGRA n° 959, novembre-décembre 2018.
- J.-M. Torrenti, X. Guillot, L. Izoret, J.-M. Potier, « Carbonatation accélérée des granulats de béton recyclé : résultats du projet national FastCarb », RGRA n° 997, mars-avril 2023.
- https://www.eupave.eu/new-fact-sheet-how-concrete-pavement-contribute-to-a-reduction-of-fuel-consumption/
- CCTG applicables aux marches publics de travaux publics – Fascicule n°65 – Exécution des ouvrages de génie civil en béton, décembre 2017.
- Les bétons décoratifs - Voiries et aménagements urbains, t. 1 : « Finitions, gestes et techniques », t. 2 : « Entretien et rénovation », t. 3 : « Les règles de l’art », Specbea.