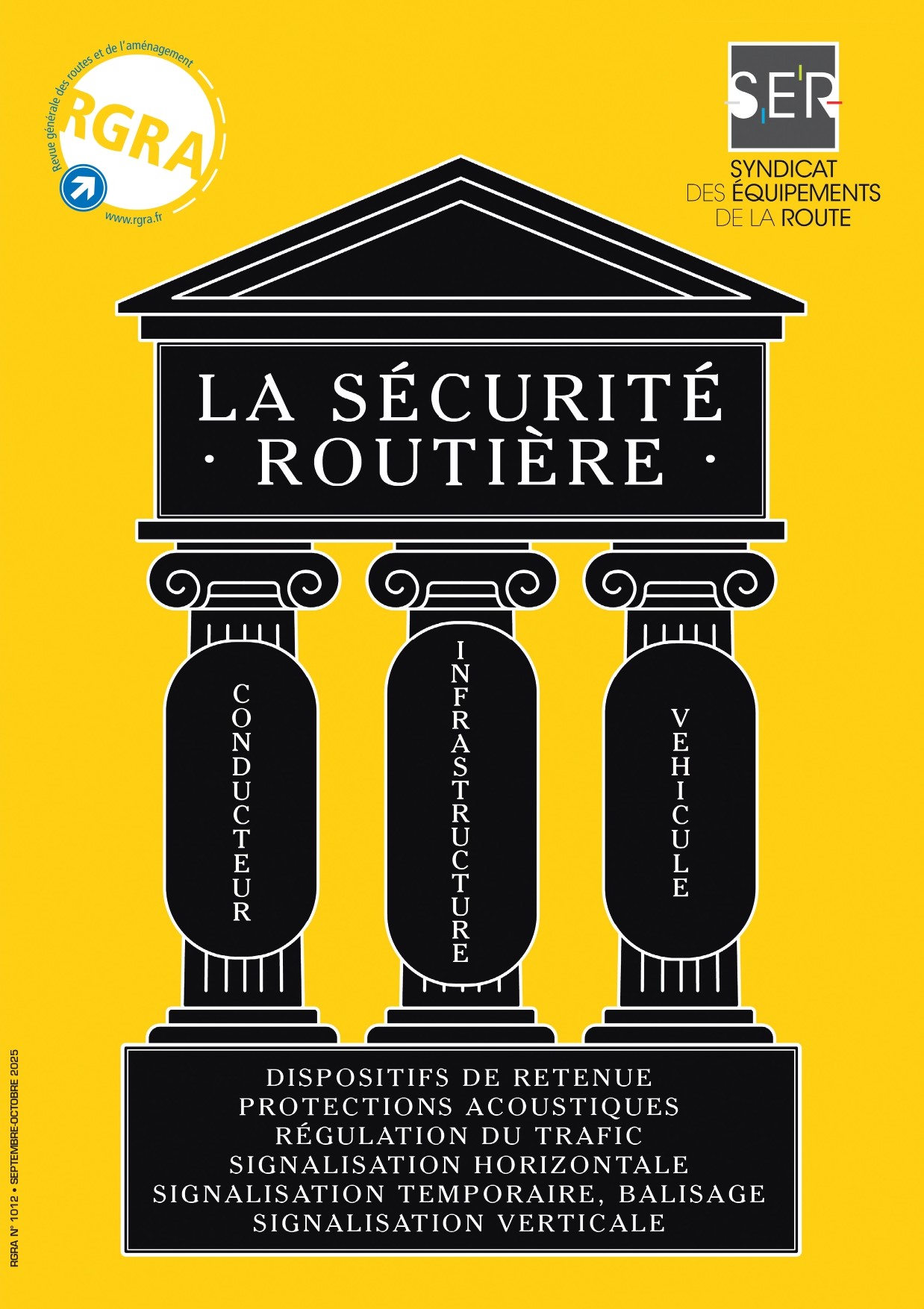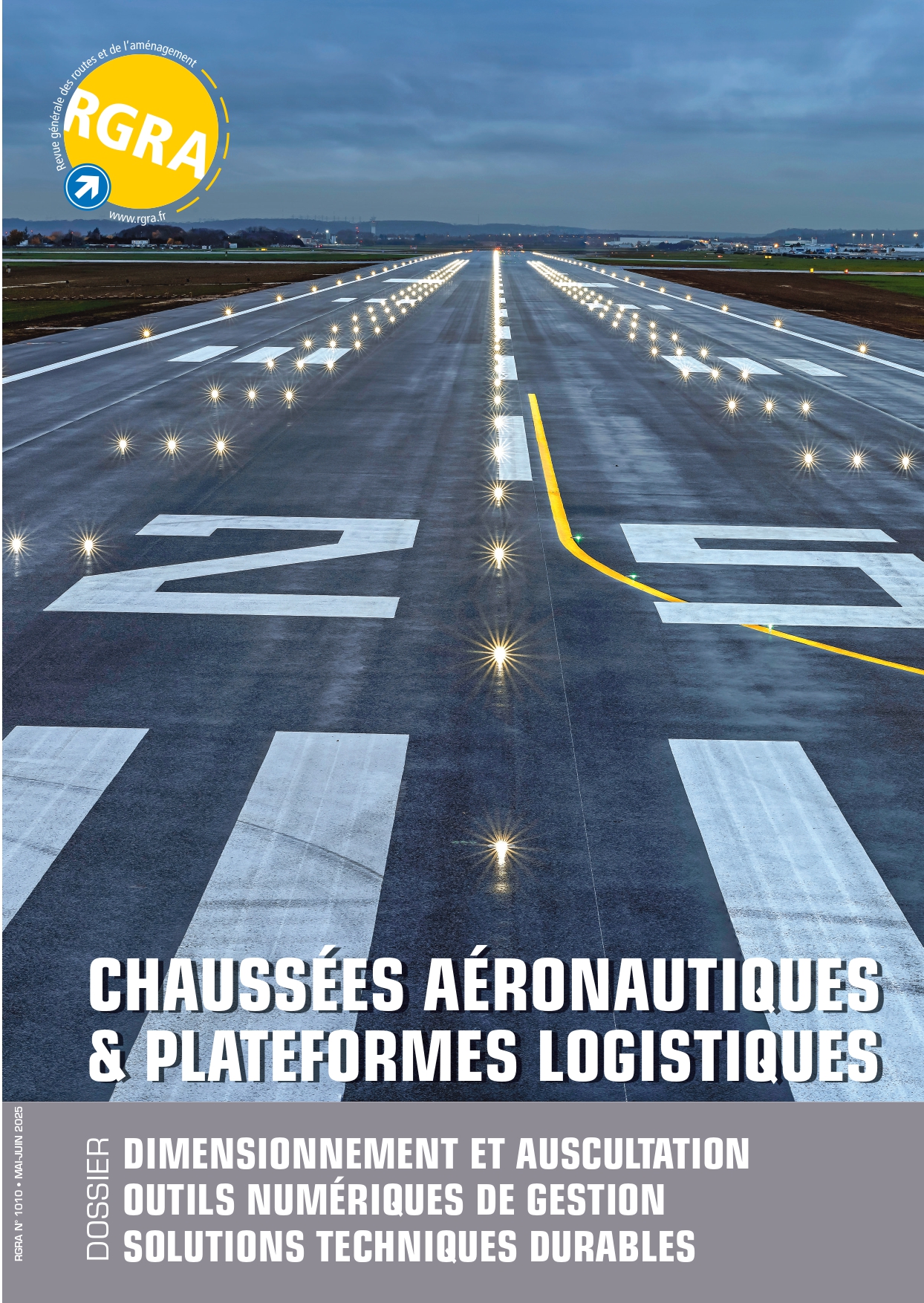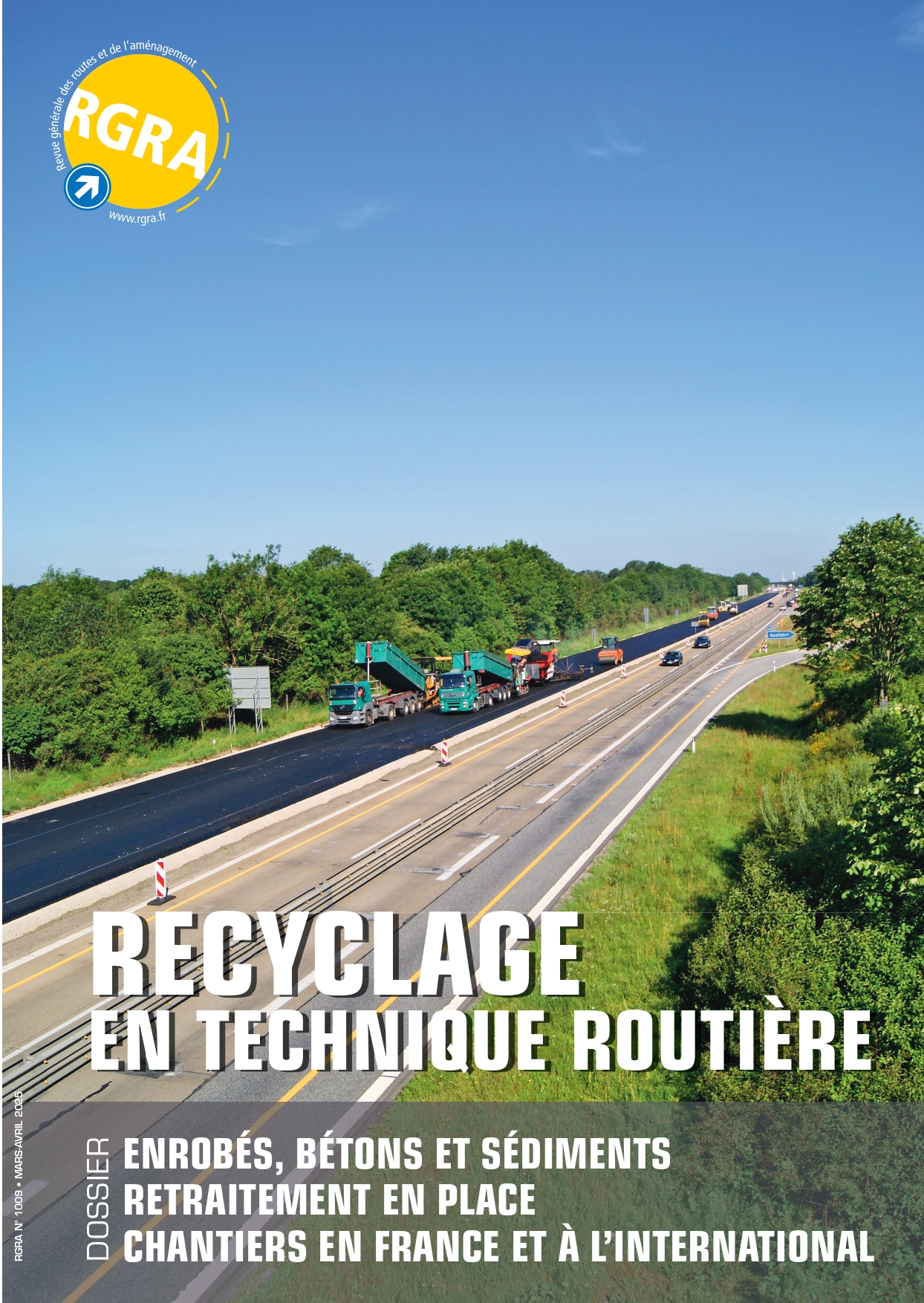Journée technique nationale du SER
Dispositifs de retenue, signalisation temporaire et balisage
Le Syndicat des équipements de la route (SER) et Transpolis ont organisé, en partenariat avec l’Ascquer, le BNTRA, le Cerema, l’ERF, l’Idrrim et la RGRA, une journée technique dédiée aux dispositifs de retenue routiers (DRR), à la signalisation temporaire et au balisage. Plus de 450 professionnels s’y sont donné rendez-vous le 25 juin 2025 sur le site de Transpolis, près de Lyon.
La journée a été rythmée par diverses démonstrations et des conférences sur les thèmes de la transition écologique, de l'entretien du patrimoine, de la réglementation, de la normalisation et la certification...
Empreinte environnementale des dispositifs de retenue routiers
Le Pacte vert pour l’Europe
C. Nicodème (ERF)
Pour rendre l'économie européenne plus durable et compétitive et ainsi relever les défis du changement climatique et de la dégradation de l’environnement, l’Europe a d’abord adopté le pacte vert (Green Deal), en 2019, puis le pacte pour une industrie propre, en 2025, impliquant un changement de paradigme (tableau 1) :
- Le pacte vert établit une vision globale de neutralité climatique d'ici 2050.
- Le pacte pour une industrie propre se concentre sur la décarbonation et la modernisation de l'industrie européenne.
tableau_1.png

Ces documents sont complétés par de très nombreux règlements et initiatives au niveau européen, parmi lesquels certains concernent plus particulièrement les équipements de la route :
- Le Green Public Procurement (GPP) impose l’intégration de critères de durabilité, de résilience et de préférence pour les marchés publics européens d'ici fin 2026.
- Le passeport numérique des produits (PNP) oblige les fabricants à fournir des informations environnementales et sur le cycle de vie des produits dans un format numérique standardisé. Ce passeport inclut un identifiant unique de produit (UPI), un numéro d'identification commerciale mondial, conformément à la norme ISO/CEI, ainsi que des informations sur les performances environnementales, la circularité et la durabilité des produits.
- La déclaration environnementale de produit (DEP), qui s’appuie sur la norme EN 15804, fournit des données objectives, comparables et vérifiées par des tiers sur les performances environnementales des produits et services tout au long de leur cycle de vie. Ces DEP, indispensables pour le futur marquage européen CE, seront obligatoires pour tous les produits marqués CE. Elles sont nécessaires pour le calcul de l'empreinte carbone totale d'un projet, sans pour autant compromettre la sécurité, par exemple en réduisant la quantité de matériaux utilisés.
Évaluer et réduire l’empreinte environnementale des DRR
J. Forêt (SER/Aximum), S. Lassalas (SER/Piveteau Bois)
Afin de répondre aux exigences réglementaires croissantes et de promouvoir une construction routière plus durable, le SER a récemment développé une approche structurée pour évaluer et réduire l'empreinte environnementale des dispositifs de retenue routiers. Cette démarche s’articule en trois étapes : mesurer, analyser et améliorer.
Mesurer l'empreinte environnementale
La réglementation française, notamment à travers la loi Grenelle II de 2010 et la réglementation environnementale RE2020, impose déjà une prise en compte de l'empreinte environnementale, principalement axée sur le secteur du bâtiment. Cependant, cette obligation s'étend progressivement aux infrastructures routières.
L'analyse du cycle de vie (ACV) des produits de construction routière révèle une complexité qui leur est spécifique : différentes entités sont responsables à chaque étape du cycle de vie du produit. Ainsi, les fabricants doivent formuler des hypothèses sur les phases ultérieures de la vie de leurs produits, ce qui peut compliquer la comparaison de l'empreinte environnementale entre différents produits. Il est donc nécessaire de prendre en compte des critères comme l'unité déclarée, l'unité fonctionnelle et la durée de vie de référence pour effectuer des comparaisons pertinentes.
Analyser les données
Les éco-comparateurs jouent un rôle clé dans l'analyse des données environnementales. Ces outils, fondées sur des données d'ACV, permettent de comparer les impacts environnementaux de divers produits ou solutions. Ils sont utilisés dans des démarches d'éco-conception et d'achats responsables, facilitant ainsi les décisions en faveur de solutions à moindre impact environnemental. Des plateformes comme SEVE-TP, Inies, DE-Bois et Cometh offrent des comparaisons détaillées des variantes de chantiers et des impacts environnementaux des matériaux et techniques utilisés.
Améliorer les pratiques
Pour améliorer les pratiques, il convient de comprendre la répartition de l'impact carbone équivalent CO2 sur un dispositif de retenue routier (figure 1).
figure_1.png

Les pistes d'amélioration incluent : la durabilité des produits, l'utilisation de matières premières de qualité, le recyclage, la réparabilité et l'optimisation de l'énergie et des transports. Ces mesures visent à réduire l'impact environnemental tout au long du cycle de vie des produits.
Entretien du patrimoine de DRR
Guide Idrrim Gestion patrimoniale des équipements de la route
P. Dumas (Idrrim)
Ce guide a pour objectif d’aider les gestionnaires à bâtir une stratégie de gestion de leurs équipements de la route, en définissant les outils et méthodes adaptés pour le recensement et le suivi de ce patrimoine. Il propose aussi des modalités de gestion au regard des fonctions portées par les équipements de la route.
Le guide s’organise en deux grandes parties :
- l’une consacrée à la stratégie de gestion patrimoniale des équipements de la route de manière générale ;
- l’autre présentant les concepts de gestion patrimoniale pour chaque catégorie d’équipement (signalisation horizontale, signalisation verticale, dispositifs de retenue, écrans acoustiques, équipements de régulation de trafic).
Table ronde Impact du passage de l’environnement NF à CE
J.-C Pannetier (DIR Ouest), F. Palma (SER/Distriroute), O. Goyat (SER/Signature), N. Simoès (APRR-AREA)
Le passage de la certification NF à la certification CE dans le domaine des équipements de la route a complexifié la gestion de ce patrimoine.
Ainsi, la certification CE, obligatoire pour les dispositifs de retenue permanents, a entraîné une multiplication des familles de produits, facilitant la circulation des produits au sein de l'Union européenne, mais compliquant leur gestion pour les acteurs locaux.
Cette transition a également transféré les responsabilités de l'État français vers les fabricants, les poseurs et les maîtres d'ouvrage, nécessitant une montée en compétence et une meilleure connaissance du patrimoine pour anticiper les travaux futurs.
Après avoir décentralisé la gestion patrimoniale de ses équipements, APRR-AREA l’a recentralisée afin de mieux répondre aux exigences des produits certifiés CE. Elle a également acquis de nouveaux outils, comme la cartographie mobile, qui peut reconstituer les infrastructures en 3D et réaliser un inventaire assez rapide des équipements.
La DIR Ouest (figure 2), qui a elle aussi centralisé cette gestion, a procédé à un recensement exhaustif de ses dispositifs de retenue routière, pour une gestion plus efficace et des réparations plus rapides.
figure_2.jpg

Dans ce contexte où les personnels chargés de la gestion patrimoniale doivent monter en compétence, les CQP (certificats de qualification professionnel) du SER trouvent tout leur sens.
Séparateurs modulaires de voies (SMV)
Il existe pour l’instant peu de références techniques sur les SMV, mais le SER travaille avec différents partenaires sur la réalisation d’une note technique ou d’un guide qui devrait pallier ce manque.
SMV de classe B pour un usage temporaire
A. Fabre (SER/Signature)
Les SMV sont utilisés pour séparer les voies de circulation ou délimiter longitudinalement une zone de chantier. Ils sont classés en deux catégories principales :
- la classe A, qui assure une fonction de séparation et de guidage ;
- la classe B, qui ajoute une fonction de retenue, souvent en béton ou en métal.
Les SMV de classe B sont caractérisés selon trois critères principaux :
- le niveau de retenue ;
- la largeur de fonctionnement (Wn) ;
- le niveau de sévérité de choc (ASI : indice de sévérité de l’accélération).
Il en existe trois catégories :
- les dispositifs couverts par une circulaire d’agrément historique ou expérimentale (photo 1) ;
- les barrières de sécurité temporaires ayant fait l’objet d’un essai de choc et satisfait aux exigences de la norme NF EN 1317 (niveau T) (photo 2) ;
- les barrières de sécurité permanentes marquées CE (certificat CE selon NF EN 1317) (niveau N, H) (photo 3).
figure_3a.png

figure_3b.png

figure_3c.png

Les SMV de classe B sont particulièrement recommandés dans des situations où la sécurité des usagers est fortement compromise ou lorsque les risques pour les intervenants sont élevés, notamment dans des zones de chantier exposées ou en cas de trafic dense.
Le pose et la dépose des SMV de classe B sont des phases de chantier à part entière avec un mode d’exploitation spécifique. Ils doivent donc être inclus dans le dossier d’exploitation sous chantier (DESC). Une réflexion préalable doit être menée par le gestionnaire de voirie afin de bien appréhender les différentes phases d’exploitation sous chantier nécessaires à la manutention des SMV.
SMV : du temporaire au définitif
W. Florkow (Eiffage Infrastructure), V. Forissier (APRR)
Un retour d'expérience sur l'autoroute A79 a montré l'efficacité des SMV : utilisés initialement pour des travaux temporaires, ils ont finalement été conservés de manière permanente pour des raisons économiques et environnementales, réduisant ainsi la production de béton et les coûts de matériaux.
Après près de trois ans d'exploitation, ces dispositifs ont prouvé leur résistance face aux chocs légers, améliorant la sécurité des usagers et des personnels. Ils peuvent aussi être remplacés rapidement en cas de dommages plus importants.
Efforts transmis sur les barrières d’ouvrages d’art
Ouvrages d’art et DRR : quels efforts prendre en compte ?
É. Colibert (Bouygues TP), B. Cauvin (Cerema), L. Corvol (SER/Rousseau), M. Poupeney (Transpolis)
Au sein du SER, un groupe de travail s’est intéressé à la détermination des efforts à prendre en compte pour les ouvrages d'art lors de l'impact d'un véhicule sur les dispositifs de retenue routiers (DRR).
Le groupe de travail a exploré pendant trois ans différentes méthodes pour évaluer ces efforts, impliquant une collaboration étroite entre divers acteurs du secteur (maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, industriels, experts en calculs…) (figure 3).
figure_4.png

Après de nombreuses réunions et des centaines d'heures de calculs, une méthode a été retenue : la mesure des efforts dynamiques par simulation utilisant un modèle numérique de corrélation validé par l'Ascquer. Cette méthode harmonisée, qui sera publiée dans le fascicule FD P98-435, autorisera une comparaison structurée et sécuritaire des produits, tout en étant contrôlable par un organisme tiers.
Dimensionnement des DRR en béton
É. Colibert (Bouygues TP), B. Cauvin (Cerema), M. Poupeney (Transpolis
Le dimensionnement des DRR des ouvrages d’art diffère selon qu’il s’agit d’ouvrages neufs ou existants.
Pour les neufs, il convient de prendre en compte :
- les efforts sur poteau (fiche fournisseur) et sur trottoir/bordure (Eurocode) ;
- une pondération par 1,25 ELU ;
- la rigidité en torsion de la longrine, qui implique une linéarisation de l’effort de barrière entre les montants.
Pour les existants, il faut considérer :
- les efforts sur poteau (fiche fournisseur) et sur trottoir/bordure (Eurocode) ;
- une pondération par 1,25 ELU ;
- l’absence ou la faible rigidité en torsion de la longrine, qui implique un effort ponctuel en pied de poteau diffusé à 1/1 dans l’épaisseur de la longrine/du hourdis.
Le cas pratique des viaducs d'Arenc et de Cazemajou, dans les Bouches-du-Rhône, a illustré les enjeux de réparation et de remplacement des DRR. Les vérifications demandées à Transpolis ont permis d'évaluer la dangerosité des barrières existantes, datant de 1975 et non validées selon la norme EN 1317. L’étude de sensibilité réalisée pour évaluer l'état des aciers et des bétons a conduit à la décision de conserver les DRR à moyen terme.
• 1er prix – Miditraçage
• 2e prix - Groupe Helios
• 3e prix – Aximum
• 4e prix – AER
• 5e prix – Rondino
Réglementation, normalisation et certification
M. Beltrami, B. Perrier, K. Smorag (Cerema)
Réglementation et normalisation
La réglementation des équipements routiers s'appuie différents types de textes, allant de la Convention de Vienne de 1968 aux arrêtés nationaux. En France, l'arrêté de 1967 et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) constituent les bases légales. Ces textes ont subi de nombreuses modifications pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux besoins de sécurité.
Les responsables de la signalisation routière ont un devoir de conseil et doivent s'assurer que les équipements utilisés sont conformes aux dispositions légales et réglementaires. La non-conformité peut entraîner des risques majeurs pour les usagers de la route, d'où l'importance de respecter scrupuleusement les normes en vigueur.
Signalisation temporaire : normalisation
M. Beltrami, B. Perrier, K. Smorag (Cerema)
La normalisation des équipements de signalisation temporaire est encadrée par des règles strictes visant à garantir leur efficacité et leur sécurité.
La commission de normalisation de la Signalisation routière verticale (CN SRV) du Bureau de normalisation des transports, des routes et de leurs aménagements (BNTRA) (figure 4) travaille activement sur différents aspects concernant les caractéristiques techniques et performances associées (performances visuelles et mécaniques, dimensions) :
- des panneaux de signalisation verticale temporaire et supports associés, produits rétro-réfléchissants temporaires ;
- des produits de balisage routier temporaire.
figure_5.png

Les normes en vigueur, comme la norme P98-532 relative aux décors de panneaux, sont régulièrement révisées pour intégrer les dernières innovations et exigences de sécurité.
Certification des équipements de la route
Ibtihal Zane, Pierre Derommelaere, Romain Giraud, Mabrouk Houari (Ascquer)
La certification des équipements de la route est un processus nécessaire pour garantir leur qualité et leur conformité aux normes. L'Association pour la certification et la qualification des équipements de la route (Ascquer) joue un rôle central dans ce domaine.
Les procédures de certification définies dans le Code de la voirie routière incluent :
- le marquage CE : barrières de sécurité, panneaux routiers permanents, produits de saupoudrage, plots réfléchissants, films rétroréfléchissants, panneaux à message variable, feux tricolores… ;
- la certification NF : barrières de sécurité génériques, panneaux routiers permanents, panneaux routiers temporaires, produits de marquage routiers, balisages, feux de chantier, films rétroréfléchissants… ;
- d’autres procédures spécifiques pour les produits innovants.
S’agissant des DRR, elles concernent les dispositifs métalliques, en béton et en bois-métal.
Les Truck Mounted Attenuators (TMA)
G. de Nacquard (SER, Tertu), M. Langlet (DIR Nord Ouest), V. Bavasso (Transpolis)
Les atténuateurs de choc montés sur camions, ou Truck Mounted Attenuators (TMA) (photo 4), sont conçus pour améliorer la sécurité des personnels qui conduisent les camions munis de flèche lumineuse de rabattement (FLR) et des usagers qui heurtent ces engins sur les chantiers routiers.
photo_2.png

Initialement développés aux États-Unis dans les années 1970, les TMA sont déjà largement déployés dans différents pays (Allemagne, Autriche, Royaume-Uni…), mais leur utilisation en France est encore à l'étude, des expérimentations en cours visant à évaluer leur efficacité et leur intégration dans le cadre réglementaire français.
Les TMA sont soumis à la norme expérimentale XP CEN/TS 16786, « Dispositifs de retenue routiers - Atténuateurs de choc montés sur camions - Classes de performance, critères d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai » de novembre 2020, qui définit :
- leurs classes de performance ;
- les critères d'acceptation des essais de choc ;
- les méthodes d'essai.
En France, l'expérimentation des TMA vise à définir leurs caractéristiques techniques conformément au Code de la route afin d'obtenir une attestation de conformité en attendant une norme européenne harmonisée. Par ailleurs, leur prise en compte dans les documents de référence des gestionnaires facilitera leur utilisation.
Pour faire prendre conscience aux participants à la journée technique du rôle que peuvent jouer les TMA, une démonstration de crash test a été organisée (photo 5).
photo_3.jpg